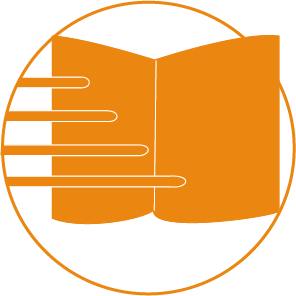Evidemment, ce n’était pas son vrai nom. Mais c’est bien comme ça que l’apostrophaient les habitués du bistrot, sur la place du village. «Panosse, viens par ici! Panosse, encore un ballon!» La jeune fille aux longs cheveux blonds ne parlait pas beaucoup, mais elle n’en pensait pas moins. Elle travaillait à la Croix-Blanche depuis plusieurs années déjà. Prunelle qu’elle s’appelait. Un prénom trop joli, bien trop inhabituel pour ces lourdauds qui venaient boire un verre de rouge dès le petit matin et qui étaient encore là à la fermeture, leurs yeux vitreux reflétant le fond du verre, le fond du verre reflétant leur hébétude. A part les habitués, elle en voyait défiler du monde au restaurant, sur la place du village. Les conseillers communaux, les voyageurs attirés par les sports d’hiver ou les courses en montagne, les invités tout de noir vêtus suite à une cérémonie funèbre… Mais aussi, les apéros de mariage, les fêtes de village, les anniversaires, toute occasion était bonne pour se retrouver, boire un verre et parfois même, pousser la chansonnette. Prunelle accueillait chacun, souriait à droite et à gauche, connaissait les petites habitudes et tournoyait, efficace et bien à son affaire, pour que chaque client soit servi et satisfait.
Autour du restaurant se dressait une foule de petites maisons bien serrées, regroupées en rangs d’oignons, aux pieds des Préalpes. Une fois son service terminé, en milieu d’après-midi, Prunelle aimait par-dessus tout se balader dans les rues de son village. Elle observait les artisans et les ouvriers affairés par leur tâche. Il y avait le chauffeur-livre-à-l’heure, le cuisinier-à-tire-d’aile, le jardinier-enchanteur et la jardinière-d’enfance… Son préféré était le souffleur-de-vers. Tandis qu’il soufflait le verre en fusion, des formes jaillissaient de ses doigts, mais aussi un bruissement de mots si doux et si mélodieux que l’atelier se remplissait de fumées colorées, de vers chatoyants, de paroles enivrantes… Ainsi, toute personne qui passait par là s’en trouvait réchauffée, égayée, emportée dans un tourbillon de verbe et de lumière…
La repasseuse-d’espoir aussi attirait Prunelle. Les piles de linge s’entassaient de tous côtés de la planche. D’un coup de fer, elle effaçait les rides de fatigue ou d’ennui. Vaporisant de l’eau de lavande, elle redonnait jeunesse et fraicheur aux tissus les plus éprouvés. D’un coup d’amidon, elle rendait force et vigueur aux cols fatigués. Dans ses promenades, Prunelle croisait souvent le chantonnier-des-rues. Il poussait sa carriole en chantant et sifflotant, ramassant un déchet par ci, des détritus sous un banc, une crotte au pied d’un arbre. Il veillait à ce que tout soit propre et agréable pour ses concitoyens.
Lorsque Prunelle terminait son travail au cours de la soirée, c’était bien différent. Chacun avait terminé son ouvrage et savourait un peu de repos avant le sommeil de la nuit. Il faut savoir que la plupart des habitants de ce village prenaient le temps de soigner une sculpture intérieure. Lorsqu’on les regardait fixement au fond des yeux, on pouvait apercevoir cette sculpture, au-delà de leur regard. Certains avaient de plus une petite vitrine, juste au-dessus du cœur, à travers laquelle on pouvait admirer cette petite construction.
Il est vrai que depuis la nuit des temps, certaines personnes se tournent vers leur intérieur autant que vers l’extérieur. Celles-ci élaborent au fil des ans, ou pendant une partie de leur vie, une sculpture intérieure faite de sentiments, d’émotions, de ressentis, de souvenirs, mais aussi de tout ce qu’elles captent, admirent, collectionnent autour d’elles. Elles sont sensibles à ce qui les entoure, savent se l’approprier et en garder quelque chose à l’intérieur. De tout ce qu’elles ont conservé, admiré, collectionné, elles embellissent leur intimité.
Ensuite, comme par un jeu de miroirs, ce que ces personnes vivent à l’intérieur transparaît à nouveau à l’extérieur, leur donne le regard pétillant, les rend plus aimables et compréhensives pour leurs proches, leur permet d’accueillir l’imprévu avec le sourire et les coups durs avec sérénité. L’amour, la beauté, les petits détails du quotidien emmagasinés sont à nouveau visibles, imperceptiblement.
Dans ce village aux pieds des Préalpes, plus qu’ailleurs, les habitants avaient développé cette aptitude et la plupart d’entre eux entretenaient leur sculpture intérieure avec un soin particulier.
Prunelle était jeune encore, elle se contentait d’ajouter distraitement à sa sculpture une fleur, un éclat de lune ou un caillou brillant trouvé au détour d’un sentier, mais elle était fascinée par certains villageois qui passaient des heures à lisser à doigts nus une sculpture de terre glaise ou qui enjolivaient la leur en ajoutant chaque jour quelques grains de sable savamment placés… Ces sculptures reflétaient l’âme de leur propriétaire, représentant leur richesse intérieure, leurs passions, leurs envies… Elles étaient toutes différentes. Le soir, certains les déposaient un instant au frais sur le rebord de leur fenêtre pour les décorer encore à la faveur d’un rayon de lune. Prunelle se promenait dans les rues, admirait et s’enrichissait de cette application et de cette attention. Cela lui permettait d’oublier les moqueries et les méchancetés de quelques-uns de ses clients.
Un jour de vacances estival, le village était presque désert. De nombreuses familles étaient parties pour une semaine ou deux. Les montagnards escaladaient les sommets, ou observaient les animaux sauvages. Au bistrot, il ne restait que les trois piliers de bar. Et ce jour-là, ils étaient particulièrement irascibles. Ils avaient décidé de pousser à bout la pauvre serveuse, l’appelant pour un rien, se moquant de sa coiffure ou de son habillement et surtout, hurlant à qui mieux-mieux ce détestable surnom «Panosse! Panosse!»
C’était plus que Prunelle ne pouvait supporter. Excédée, elle posa son tablier sur le comptoir, prit sa bourse sous le bras et, sans un mot, sortit en claquant la porte. Sans réfléchir, elle rentra chez elle, enfourna quelques habits dans un sac de voyage et repartit en courant jusqu’au bord de la grand-route. Le chauffeur-livre-à-l’heure ne tarda pas à passer et s’arrêta à sa hauteur lui demandant s’il pouvait lui rendre service. Il l’emmena jusqu’à la ville, juste devant la gare. Elle acheta un billet et le train l’emporta à travers plaines et collines, des heures durant, jusqu’à une grande ville au bord de la mer. C’est là qu’elle s’arrêta.
Les semaines succédèrent aux jours et les mois aux semaines. Prunelle avait trouvé une petite chambre. Elle passait d’un bar à l’autre, d’un employeur à l’autre, claquant la porte à chaque fois qu’on lui manquait de respect ou qu’on se moquait de ses longs cheveux blonds.
Pendant ses jours de congé, elle cherchait à observer les artisans, comme à son habitude. Elle ne trouvait que des machines faites de roues et de maillets claquants et tonitruants. Elle tentait de découvrir comment les habitants de cette ville décoraient leur sculpture intérieure, mais en les regardant bien droit dans les yeux, elle ne voyait que tristesse et absence. Elle avait même essayé de guigner sous les habits de certains, à la hauteur du cœur, pour apercevoir la petite vitrine, lucarne des sentiments, elle n’avait trouvé que rudesse, avidité et égoïsme. Alors le soir, elle levait les yeux plus haut que le toit des maisons, pour apercevoir les étoiles qui scintillaient et elle repensait à la beauté de ses montagnes. Ou alors, elle s’asseyait sur la plage et faisait glisser le sable fin entre ses doigts. Elle respirait profondément l’air chargé de sel. Enfin, elle avait l’impression de rafraichir un peu sa propre sculpture.
Dire que Prunelle dépérissait dans la grande ville n’est pas exagéré. Un jour, sur un coup de tête, elle monta sur un paquebot et s’engagea au service du capitaine. Elle aidait à la cuisine et servait les plats en cabine. L’air du large, les cris des oiseaux, l’immensité de l’étendue d’eau la rassérénaient et lui faisaient oublier la grisaille et la froidure de la cité.
Arrivée de l’autre côté de l’océan, une nouvelle grande ville l’attendait, avec ses maisons immenses, ses rues bordées de bars et de petits restaurants, ses grandes places, ses fêtes foraines. Là, elle crut un instant retrouver la joie de vivre de son enfance, mais ce n‘était qu’un miroir aux alouettes. Après les éclats de rire, les gourmandises et les émotions fortes, les lumières s’éteignaient et chacun rentrait chez soi.
Elle cherchait dans les ruelles un souffleur-de-vers, un chantonnier-des-rues ou une repasseuse-d’espoir, elle ne trouva que des maître-queux, des ferblantiers-couvreurs, des géomètres-arpenteurs et une institutrice-à-chignon. Enfin, alors qu’elle allait perdre espoir, elle aperçut un égreneur-de-rengaines. Il était placé au bout du pont, il tournait régulièrement et sans se lasser la manivelle de son orgue de Barbarie. Une petite coupe recueillait les rares piécettes que les passants pressés voulaient bien lui jeter. Et lui, il fermait les yeux. Lorsque Prunelle lui dit bonjour, il ouvrit les paupières et c’est là qu’elle vit, au fond de son regard, des milliers d’étoiles et des oiseaux migrateurs perchés sur un fil. Quelle jolie peinture intérieure! Elle lui sourit et continua son chemin.
Le soir-même, elle reçut un message de sa voisine au village. Celle-ci disait que sa grand-mère était au plus mal. Instantanément, la jeune fille sentit dans sa bouche les saveurs des desserts de son enfance, les petits fruits qu’elle allait ramasser l’automne avec sa grand-mère. Elle entendit à nouveau les berceuses qu’elle lui chantait en patois pour l’endormir au coin du feu. Elle sentit sur sa peau la douceur des caresses parfumées au sortir du bain et, enfin, elle vit le regard malicieux de sa grand-mère dans le bleu duquel elle pouvait perdre le sien et apercevoir l’immensité du ciel et la profondeur de la mer. Son aïeule avait su élaborer une sculpture d’eau et de glace, de sources et de cascades, des milliers de gouttelettes en mouvement. Sans réfléchir plus longuement, Prunelle fit son paquetage et trouva le moyen le plus rapide pour retourner chez elle.
Arrivée au chevet de sa grand-mère, elle la trouva très faible, couchée sur son lit. La vieille dame ouvrit délicatement les yeux lorsque Prunelle s’approcha et lui prit doucement la main. Plongeant son regard dans le sien, sa petite-fille aperçut une sculpture très belle, fragile et ajourée, des traces de calcaire déposées par l’eau, de l’eau en filigrane, une vraie dentelle. Emue jusqu’aux larmes, Prunelle avait les lèvres qui tremblaient et ne pouvait articuler un son. Sa grand-mère baissa les paupières et dit dans un souffle: «Prends garde à ta sculpture, ma chérie. Sable, caillou, fleurs ou papier, rien ne sert. C’est ton temps et ton attention qui importent.» Prunelle embrassa pour la dernière fois sa grand-mère, sur les paupières, et sortit sur la pointe des pieds.
Une fois passées les nuits de veille, les allées-venues au cimetière et les ribambelles d’embrassades, Prunelle reprit le cours de sa vie. Un après-midi, elle croisa à l’arrière du restaurant l’un des habitués qu’elle connaissait depuis si longtemps. Elle planta son regard dans le sien et comprit toute sa lassitude en apercevant une sculpture de glaise toute flasque, presque effondrée. Elle détourna les yeux et prit rapidement le chemin de la montagne.
Ses chères Préalpes! Après tant de chemin parcouru, tant d’impasses et de détours, c’est là qu’elle se sentait bien. Foulant le gravier du chemin, cueillant des fleurs, mordillant des bourgeons de sapin, elle sentit monter en elle un souffle nouveau, elle sentit renaître en elle l’envie de vivre, elle sentit grandir en elle un espace pour soigner sa sculpture intérieure.
Dès lors, pas un jour ne passa sans qu’elle prenne le temps d’arpenter les montagnes, de contempler la vue de la plaine, de chanter à tue-tête, de lire des poèmes adossée à un arbre, de faire des colliers de pâquerettes. Tout ce temps considéré comme inutile par tous les experts-comptables, c’était du temps précieux pour l’élaboration de sa sculpture qui grandissait petit à petit.
Dans la farandole de l’automne, alors que les petits retrouvaient le chemin de l’école, que les paysans rentraient les récoltes, que les vaches descendaient de l’alpage, que les vieux se reposaient de leur longue existence, Prunelle cherchait une petite maison pour abriter son nouveau projet. Elle avait mûrement réfléchi tout au long de l’été, en cavalant dans les sous-bois et en dévalant les pentes. C’est par un beau matin brumeux qu’elle trouva une bicoque inhabitée à la sortie du village, au bord de la route qui mène à la ville. Elle y installa son magasin de fleurs.
Chaque matin, très tôt, elle parcourait les campagnes, les champs ou le flanc des montagnes pour cueillir des fleurs toutes fraiches. Elle en commandait aussi aux marchands qui les apportaient de pays lointains. Dans sa boutique, jour après jour, elle accueillait un amoureux transi, une jeune mariée impatiente, les enfants avec leurs quelques pièces lors de la fête des mères, les papas au jour de la naissance de leur premier-né, les familles en deuil, les amis au cœur plein de sourires ou de larmes avant une visite… Pour chacun, Prunelle avait une oreille attentive, un sourire franc, malicieux ou compréhensif. Pour chacun, elle préparait un petit arrangement, un bouquet ou une couronne, mariant les couleurs, ajustant les formes…
Chaque soir, à la lueur d’une bougie, reposant ses mains fatiguées, laissant ses pensées s’échapper, elle embellissait sa sculpture de toutes les couleurs de ses fleurs, de toutes les émotions de ses journées… Ainsi passaient les jours, sereins et toujours différents.
C’est sur le seuil de sa boutique qu’elle vit un matin arriver un jeune monsieur, très grand et un peu emprunté. Il désirait un bouquet pour sa maman qu’il n’avait pas vue depuis longtemps et à qui il venait rendre visite au village. Plantant son regard dans ses yeux tristes, Prunelle découvrit un océan d’attente et des mouettes criant de solitude. Emue, elle prépara un bouquet de magnifiques roses de toutes les couleurs, avec un beau ruban. Le jeune monsieur s’en alla, son bouquet sous le bras.
Le soir, la nuit était tombée depuis longtemps lorsque la fleuriste entendit toquer à la fenêtre. Quand elle ouvrit, elle reconnut dans la pénombre le jeune homme du matin. Il avait oublié son chapeau. Elle lui proposa d’entrer, il n’est jamais reparti!
Patiemment, inlassablement, ils ajustèrent leurs sculptures, échangeant les matériaux, agrémentant de rires l’équilibrage, dressant des perches de lumière, tendant des fils de mots en rime, jusqu’à ce que naissent des bébés joufflus couverts de fleurs et de chapeaux…
Ketsia Sâad
Février 2016
Publié dans le
“Prix littéraire de la Ville de Gruyères 2016”, Editions de l’Hèbe